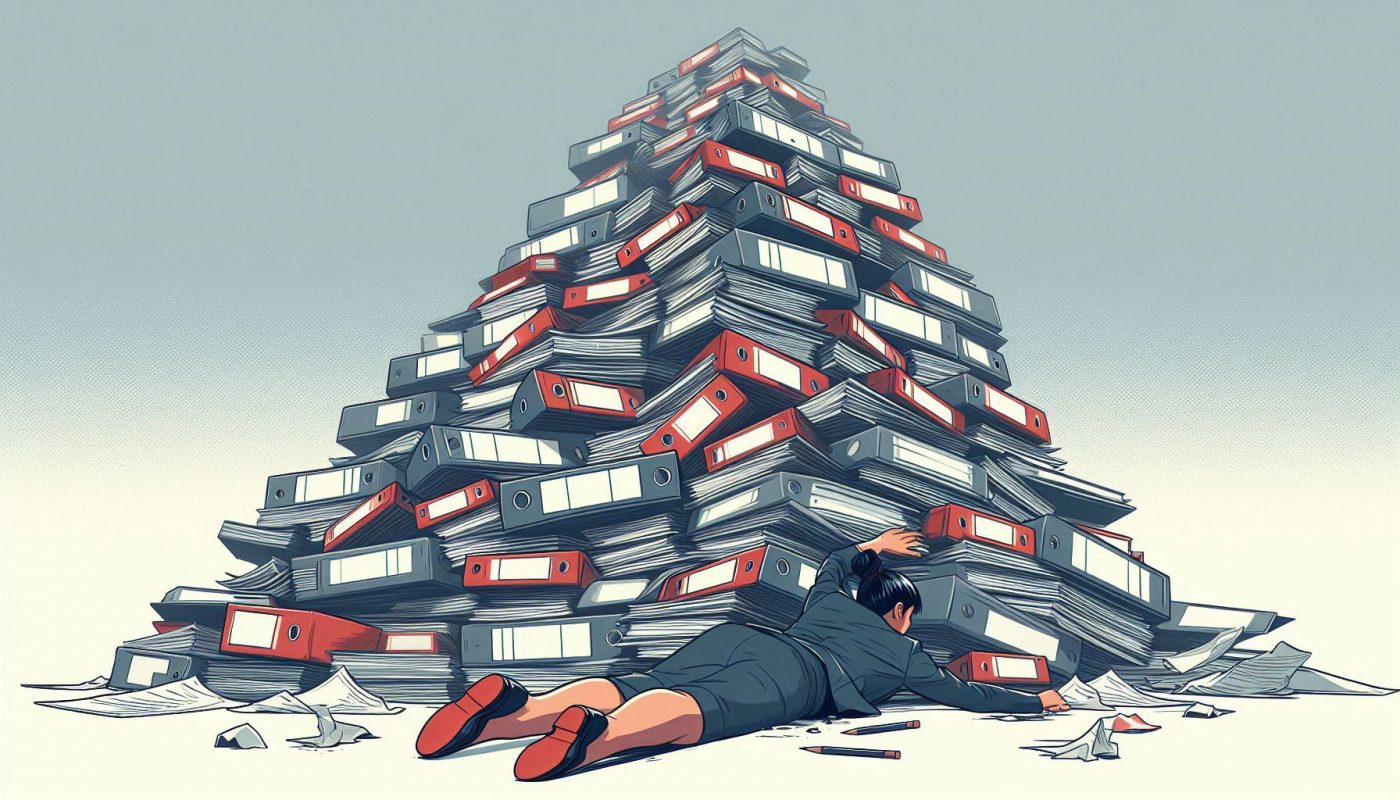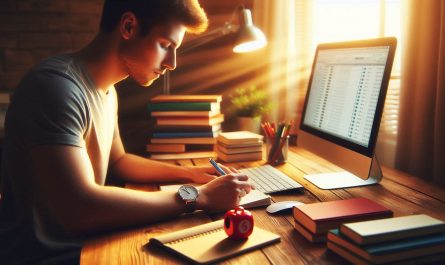Plus vous travaillez dur, plus vous avancerez… Voilà un mythe qui a la dent dure. Comme si le temps passé à travailler était automatiquement synonyme de progrès, de productivité, d’efficacité. Alors, vous rallongez vos journées déjà bien occupées, faites l’impasse sur quelques temps morts ou peut-être avez-vous déjà sacrifié un peu de temps dans les bras de Morphée en pensant faire ce qu’il faut pour atteindre vos objectifs.
C’est exactement ce qu’a pointé Ivan Illich, un penseur un peu à contre-courant qui a mis les pieds dans le plat dès les années 70. Selon lui, chaque activité humaine (travail compris) a un seuil au-delà duquel elle devient contre-productive. Autrement dit, à partir d’un certain point, continuer de forcer n’améliore pas les choses, au contraire, ça les empire.
À partir de ce moment, la fatigue cognitive s’installe, la concentration diminue, les erreurs se multiplient et l’efficacité générale prend un coup. Ce qui pouvait être réglé en une heure dans un état de fraîcheur matinale finit par s’éterniser sur deux ou trois heures, simplement parce qu’on a dépassé ce point de bascule sans s’en apercevoir.
Évidemment, dans un environnement où l’intensité de travail est valorisée, où l’on confond facilement présence et performance, il devient essentiel de repenser la manière dont on mesure notre efficacité. C’est pourquoi je vous propose de voir ensemble comment la loi d’Illich peut vous aider à retrouver un équilibre entre effort, temps et productivité.
I. Pourquoi cette loi vous concerne
Avant de passer aux conseils pratiques, prenons un moment pour bien saisir ensemble ce qui se cache derrière cette loi. Comprendre ses principes, que vous ne connaissez peut-être pas mais qui vous connaissent.
1. Les symptômes qu’on reconnaît trop bien
A. Vous vous arrêtez régulièrement à l’épuisement

Lorsque vous travaillez à votre compte ou gérez vos propres projets, il est facile de basculer dans un rythme effréné où vous ne comptez pas vos heures.
Votre seul indicateur de pause devient alors la fatigue. Tant que votre corps tient debout, vous continuez.
Le plus souvent par motivation, vous avez envie d’avancer, de bien faire et de répondre aux attentes (les vôtres comme celles des autres) si bien que vous continuez même lorsque votre capacité réelle à produire s’est effondrée. Ce n’est plus votre lucidité qui vous guide, mais l’élan du devoir ou l’illusion d’un résultat imminent.
B. Vous culpabilisez dès que vous levez le pied
À peine avez-vous pris quelques minutes pour souffler que vous sentez déjà la petite voix dans votre tête qui vous reproche de ne pas “profiter” de ce temps pour avancer. Vous vous surprenez à regarder votre montre, à penser à tout ce que vous auriez pu faire pendant cette pause.
Ce sentiment de culpabilité n’est pas anodin, en tout cas il n’apparaît pas par hasard. Il est souvent le résultat d’un conditionnement profond, celui qui associe valeur personnelle et quantité de travail abattu. Vous avez intégré sans vous en rendre compte que ralentir c’était perdre du temps, que vous reposer c’était trahir vos objectifs et qu’un emploi du temps pas totalement rempli était forcément le signe d’un manque d’ambition ou de rigueur.
Mais en réalité, c’est ce type de pensée qui vous épuise bien plus que le travail lui-même. Car même quand vous vous autorisez une coupure, vous ne vous accordez pas vraiment le droit de penser à autre chose que le travail en cours.
2. Le piège de la productivité toxique
A. La glorification des longues journées dans l’entrepreneuriat
Travailler tard le soir, commencer avant le lever du soleil… tout cela est trop souvent perçu comme un signe d’engagement, de discipline et de mérite. On finit presque par croire qu’un entrepreneur qui ne frôle pas le burn-out ne travaille pas assez.
Ce conditionnement est d’autant plus pervers qu’il brouille totalement la notion d’efficacité. On mesure alors la valeur de son travail au nombre d’heures passées devant un écran, à la quantité de tâches alignées sur une to-do list, sans se demander si ces heures ont été utiles, si elles ont réellement fait avancer les choses, ou si elles n’ont pas simplement nourri un besoin d’auto-validation.
C. Le multitâche et le faux sentiment d’avancer

Passer d’un onglet à l’autre, répondre à un message en plein milieu d’une tâche, consulter ses mails entre deux lignes d’un rapport, brainstormer en cuisinant ou en scrollant sur LinkedIn… Cela vous semble familier ?
Le multitâche s’est imposé dans notre quotidien comme une compétence à valoriser. Comme si faire plusieurs choses à la fois était un signe de performance ou de dynamisme.
La vérité, c’est que notre cerveau n’est pas conçu pour se concentrer pleinement sur plusieurs activités cognitives complexes en même temps. Ce que vous appelez « multitâche » c’est en réalité une succession rapide de micro-switchs attentionnels. À chaque changement vous perdez du temps à retrouver le fil.
II. Organisez vos journées avec la loi d’Illich
Après avoir compris les bases de cette loi, voyons comment l’appliquer pour mieux organiser vos journées. Rien de compliqué, vous verrez… juste quelques bons réflexes à prendre.
1. Acceptez de ralentir pour mieux durer
Dans notre société, la croissance est souvent perçue comme une fin en soi : il faut plus de clients, plus de revenus, plus de résultats. Peu importe si cela exige toujours plus d’heures, plus de stress ou plus de sacrifices personnels.
Vouloir faire grandir son activité, générer plus de revenus ou se faire connaître est totalement légitime. Cependant, lorsque cette envie se transforme en obsession, elle vous pousse à travailler plus longtemps, à ne jamais décrocher et à repousser sans cesse vos limites, en croyant que chaque effort supplémentaire vous rapprochera du « niveau suivant ».
Vous entrez alors dans ce qu’Illich appelait une « zone contre-productive », où continuer d’insister devient non seulement inefficace, mais également nuisible.
Alors, pensez à alléger volontairement certaines journées, notamment en fin de semaine. Personnellement, je réduis le nombre de tâches prévues le vendredi (seulement), ce qui me permet de glisser doucement vers le week-end, de préserver ma motivation et de vivre cette journée comme une récompense du travail accompli tout au long de la semaine.
2. Ajouter des moments de convivialité dans votre emploi du temps

Lorsque chaque minute est remplie, planifiée, optimisée, les échanges gratuits, les pauses légères et les conversations spontanées finissent souvent relégués au second plan.
Ivan Illich avait bien compris que, dans une société obsédée par l’efficacité, la convivialité n’était pas un bonus mais une nécessité. D’ailleurs, il oppose les systèmes humains, souples et coopératifs, aux systèmes industriels rigides et impersonnels. Ainsi, son message est clair : quand le lien social se délite, l’individu perd en autonomie, en créativité, en vitalité.
Alors, au lieu d’optimiser chaque créneau de votre agenda, choisissez délibérément de laisser de la place à ces moments qui ne produisent rien de tangible, mais qui vous nourrissent profondément. Par exemple, un déjeuner partagé sans parler boulot, une discussion autour d’un café, ou même un temps calme en famille. Ce ne sont pas des freins à la productivité, mais des tremplins pour repartir plus efficacement.
3. Favorisez l’autonomie plutôt que l’optimisation permanente
Illich était particulièrement critique envers la tendance moderne à utiliser des technologies et des méthodes de travail de plus en plus complexes, convaincu que ces “améliorations” finissent souvent par nous aliéner plutôt que nous libérer.
À force d’avoir à gérer des interfaces pour toutes les tâches de votre travail, vous perdez en efficacité.
Alors, pour rester dans l’esprit de la loi d’Illich, privilégiez la simplicité. Cela signifie choisir quelques outils que vous maîtrisez (j’insiste sur ce point) et qui correspondent vraiment à vos besoins, même s’ils ne sont pas très tendance dans votre activité.
4. Diviser les cycles de travail trop longs

Le cerveau humain fonctionne selon des rythmes ultradiens : des cycles d’environ 90 minutes durant lesquels notre attention monte, culmine, puis redescend naturellement.
Je vous rassure, la loi d’Illich ne parlait pas directement de neurosciences, mais son principe s’applique ici.
Donc, l’un des moyens les plus simples d’éviter cet écueil est de structurer sa journée en blocs (batch) de concentration, en travaillant 60 à 90 minutes sur une tâche définie, puis en vous accordant une courte phase de récupération pour préserver la qualité de votre attention sans l’étirer au-delà de vos limites naturelles.
5. Évitez de planifier votre semaine sur un coup de motivation
Il est tout à fait normal d’avoir des pics de motivation, parfois même très forts, qui vous donnent l’impression que vous allez tout déchirer dans les jours à venir. Ce coup de boost est précieux, cependant, tenez compte que demain, ou dans deux jours, votre motivation pourrait ne pas être au rendez-vous.
C’est pourquoi il est essentiel de ne pas planifier toute votre semaine uniquement sur cette énergie du moment. Votre capacité de travail fluctue naturellement et intégrer un peu de souplesse dans l’organisation de vos journées vous évitera bien des frustrations de ne pas pouvoir terminer.
Libre à vous d’ailleurs de profiter pleinement de ces moments de grande motivation pour vous attaquer aux tâches les plus complexes et exigeantes, celles qui demandent concentration et effort soutenu. En contrepartie, vous pourrez alléger les journées suivantes, en réservant des tâches plus simples.
Ce qu’il faut retenir
Vous l’aurez compris, la loi d’Illich n’est pas un conseil de plus à ajouter à votre boîte à outils, mais plutôt un principe de réalité. Ce seuil de productivité décrit ici ne dépend ni de votre volonté, ni de votre motivation.
Il est biologique, mental et contextuel.
Autrement dit, ce n’est pas parce que vous êtes capable de continuer que vous devez nécessairement le faire. La performance durable ne repose pas sur l’endurance brute, mais sur votre capacité à reconnaître quand vos ressources cognitives, physiques et émotionnelles ne sont plus alignées avec l’intensité de l’effort que vous imposez.
Personnellement, je pense que la loi d’Illich n’est pas un appel à ralentir pour se préserver passivement, mais à se construire une forme d’intelligence de l’effort. Pour choisir les bons moments pour intensifier et ceux pour lesquels vous pouvez relâcher, distinguer les tâches qui méritent votre attention pleine et celles qui peuvent attendre.