Aujourd’hui, il suffit de taper “gagner du temps” sur Google pour tomber sur des centaines de conseils plus ou moins vagues. Planifiez mieux, priorisez vos tâches, dites non plus souvent…
Tout ça part d’une bonne intention, mais quand on est sous l’eau, les projets qui s’enchaînent et la fatigue de fond, ce n’est pas une citation inspirante qui va changer quoi que ce soit. Ce qu’il faut, c’est une méthode claire, structurée, et surtout applicable à votre réalité.
Je vous rassure, non, on ne va pas parler ici de Taylor en long, en large et en travers. Pas besoin de connaître sa biographie ou de se replonger dans les usines du XIXe siècle pour comprendre ce qu’on peut en tirer aujourd’hui. Ce qui nous intéresse, c’est le cœur de son approche : comment découper intelligemment le travail, éviter les gaspillages de temps et d’énergie, et organiser ses journées pour être plus efficace sans trop s’épuiser.
Alors, traduisons ensemble la loi de Taylor dans votre quotidien moderne, loin des chaînes de montage d’autrefois.
I. Ce que Taylor avait compris
Avant de chercher à appliquer ses principes, il faut d’abord comprendre ce que Taylor avait réellement saisi du travail humain. Parce que derrière ses chronomètres et ses méthodes industrielles, il y avait une idée bien plus profonde qu’on ne le croit.
1. Plus on découpe, plus on avance
Frederick Taylor a fondé toute sa méthode sur l’idée que pour avancer efficacement, il faut découper le travail en petites étapes précises. Plus une tâche est décomposée, moins elle paraît lourde, plus on sait exactement ce qu’on doit faire et plus on avance vite.
Dans le monde industriel où Taylor a commencé à réfléchir à la productivité, cela voulait dire observer chaque geste de l’ouvrier, mesurer ses mouvements, et réorganiser le travail pour éliminer tout ce qui n’était pas strictement nécessaire. Le but était de minimiser les efforts inutiles, réduire la fatigue, et augmenter le rythme sans sacrifier la qualité.
Transposé à notre quotidien, ce principe est tout aussi pertinent, même si vous n’êtes pas sur une chaîne de montage. Si vous devez par exemple rédiger un article, gérer vos emails, ou organiser un projet, vous ne pouvez pas essayer de tout faire en même temps, sans plan. Vous perdez de l’énergie à vous demander ce que vous devez faire ensuite.
Ainsi, le cerveau fatigue, la concentration chute, et la procrastination prend le relais.
2. Moins on change de tâche, plus on avance vite
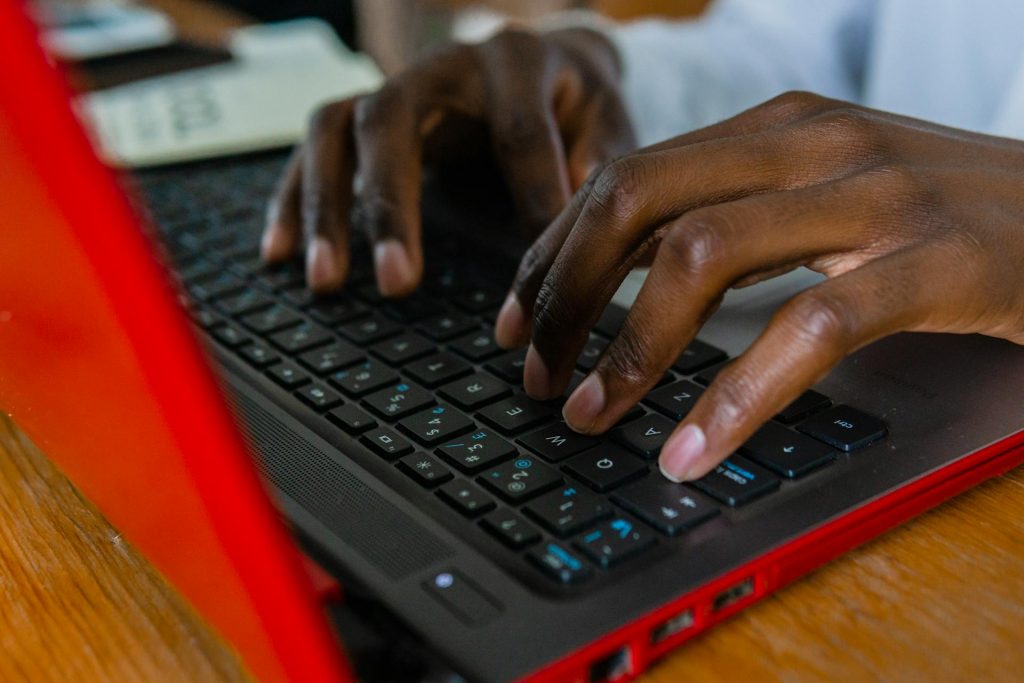
Si Taylor a insisté sur le découpage des tâches, il a aussi compris que changer trop souvent de tâche, c’est tuer votre productivité. En clair, plus vous sautez d’une activité à une autre, moins vous avancez efficacement.
Vous l’avez sûrement déjà expérimenté : vous commencez à répondre à un mail, puis quelque chose d’autre vous attire ailleurs, vous basculez sur une autre tâche, puis vous rentrez en visioconférence et avant même de vous en rendre compte, vous avez perdu le fil de ce que vous faisiez au départ.
Taylor, en observant les ouvriers, avait déjà repéré ce phénomène. Chaque changement d’outil, de mouvement, ou de poste générait une “perte de temps” cachée. C’est cette micro-perte, accumulée tout au long d’une journée, qui finit par grignoter des heures entières.
Dans notre monde moderne, les mauvaises habitudes ont la vie dure. En effet, on n’a jamais été autant bombardé de sollicitations depuis l’invention de nos écrans. Résultat, on se retrouve souvent à courir après le temps, avec cette impression parfois de courir dans le vide.
3. Ce que vous ne maîtrisez pas vous épuise
Dans la vie professionnelle, ce « flou » peut prendre plusieurs formes comme un planning trop vague, des objectifs mal définis, des tâches mal découpées, ou tout simplement un manque d’anticipation.
Parce que le cerveau humain déteste l’incertitude.
Dès qu’il manque des informations claires, il mobilise une partie importante de ses ressources pour combler les blancs, imaginer des scénarios, anticiper des problèmes potentiels, ou chercher comment s’en sortir.
Taylor, avec sa méthode, propose justement de ramener de la clarté dans chaque geste, chaque étape, pour limiter cette dépense inutile d’énergie. Quand on sait précisément ce qu’on doit faire, comment, et quand, on ne gaspille plus de temps à réfléchir ou à s’inquiéter.
II. Créer votre propre organisation “taylorienne”
On n’est plus à l’époque des usines à vapeur, certes, mais certains principes de Taylor peuvent encore faire leurs preuves dans vos journées surchargées.
1. Automatisez ce qui se répète
L’une des forces de la méthode Taylor, c’est de repérer ce qui revient régulièrement dans votre travail pour l’automatiser. Parce que refaire la même chose encore et encore, vous prend du temps et de l’énergie. Alors, autant trouver des moyens simples pour alléger votre tête et gagner en efficacité.
Dans votre quotidien, vous avez forcément des tâches qui se répètent comme envoyer une facture, répondre à certains mails types, planifier des rendez-vous, relancer un client, publier du contenu… Si vous ne structurez pas ces actions, elles deviennent vite chronophages.
L’automatisation, ne se limite pas à créer des modèles d’emails ou des checklists, même si c’est un excellent point de départ, elle peut aussi s’appuyer sur des outils et logiciels conçus pour vous simplifier la vie. Des plateformes comme Zapier, Make (ex-Integromat), ou encore les automatisations natives dans Gmail, Outlook, Trello ou Notion permettent de créer des ponts entre vos applications et de déléguer certaines tâches récurrentes à la machine.
Ce sont des petits réglages qui, cumulés, vous libèrent un temps précieux. Alors pensez y !
2. Organisez vos tâches comme une ligne de production

Un autre principe clé inspiré de Taylor, c’est le batching ou l’art de regrouper les tâches similaires pour les faire d’un coup, comme sur une ligne de production. Plutôt que de sauter constamment d’une activité à une autre, vous vous concentrez sur un même type de travail pendant un créneau dédié.
Le problème du travail fractionné, c’est qu’il vous oblige à relancer votre attention plusieurs fois. Par exemple, si vous commencez à écrire un article, puis vous passez à vos emails, puis à une réunion, puis vous revenez à l’article. À chaque interruption, votre cerveau doit repartir à zéro, ce qui fait chuter votre efficacité.
C’est ce qu’on appelle le “coût de transition”, et il est loin d’être négligeable.
Avec le batching, vous décidez par exemple de consacrer une heure uniquement à la rédaction de contenus, puis un autre créneau à la gestion des emails, puis un autre encore à la prospection ou à la facturation. Vous évitez les allers-retours inutiles, et vous vous donnez les moyens d’entrer dans un état de concentration profonde.
3. Ajoutez de la souplesse dans la gestion de votre temps
Avoir une organisation efficace ne signifie pas s’enfermer dans un planning rigide et inflexible. Au contraire, il faut apprendre à bâtir un cadre qui vous structure tout en restant suffisamment souple pour s’adapter aux imprévus et à votre rythme personnel.
La vraie maîtrise du temps, c’est savoir quand rester ferme et quand lâcher du lest.
Dans la vraie vie, les interruptions, urgences, ou changements de priorité sont monnaie courante. Plutôt que de lutter contre ces aléas, intégrez les dans votre organisation. Par exemple, prévoyez des plages horaires « tampon » pour absorber les imprévus, sans que cela ne bouleverse toute votre journée.
S’autoriser à réorganiser son planning selon les priorités du moment, sans culpabilité, est aussi un signe de maturité organisationnelle. L’objectif n’est pas la perfection minute par minute, mais une progression constante vers vos objectifs. Ainsi vous resterez maître de votre emploi du temps.
III. Les erreurs courantes à éviter
On parle souvent des bonnes méthodes, mais peu évoquent les erreurs qui freinent vraiment la productivité. Ainsi, savoir les reconnaître est à mon sens essentiel avant de vous lancer.
1. Confondre productivité et précipitation

Malheureusement, la précipitation donne l’illusion d’efficacité parce qu’on a l’impression d’être occupé, mais elle masque souvent un travail mal fait, des erreurs qu’il faudra corriger, ou des tâches recommencées. Vous pouvez passer une heure à sauter d’une activité à une autre sans jamais vraiment terminer quoi que ce soit.
C’est épuisant et surtout contre-productif.
La vraie productivité, c’est au contraire savoir doser son énergie, prendre le temps nécessaire pour chaque tâche, et avancer de façon ciblée. C’est avoir une vision claire de ce qui doit être fait et aussi accepter que certaines actions demandent du temps.
2. Faire l’impasse sur les pauses au nom de la productivité
C’est un piège qui s’habille souvent du discours “il faut bosser dur pour réussir”. La réalité, c’est qu’après un certains temps de concentration intense, on commence à fatiguer, à perdre en efficacité.
On le voit bien à travers le succès de certaines méthodes de travail comme la méthode Pomodoro qui alterne les moments de pauses et de travail. Ce n’est pas pour faire joli ou pour coller un nom italien sur une technique à la mode. C’est parce que notre cerveau a besoin de respirations régulières pour rester performant.
Il faut aussi tordre le cou à cette idée reçue selon laquelle “faire une pause, c’est perdre du temps”. C’est tout l’inverse et ce n’est pas non plus une question de luxe réservé à ceux qui ont du temps.
3. Procrastiner en planifiant trop

Le pire, c’est que ça donne bonne conscience. Vous avez l’impression d’être productif, puisque vous êtes “actif”. Mais en réalité, c’est une forme de procrastination bien déguisée.
Cependant, derrière cette tendance à vouloir tout planifier se cache souvent une peur, comme celle de se tromper, de mal faire ou encore de ne pas savoir par où commencer. Vous cherchez alors la méthode parfaite, la structure idéale et le planning irréprochable.
Alors, à un moment, il faut y aller même si ce n’est pas parfait.
Rappelez-vous qu’une bonne organisation, ce n’est pas celle qui prend une après-midi à construire mais celle qui vous permet d’agir sans y penser.
Ce qu’il faut retenir
Finalement, être productif n’est pas un objectif en soi, mais un moyen de mieux vivre ses journées et de se réapproprier son temps au lieu de courir derrière.
Travailler mieux, ce n’est pas forcément faire plus, bien que beaucoup confondent mouvement et progrès.
Ce que nous enseigne l’approche de Taylor et les évolutions plus modernes de sa logique, c’est qu’il y a une vraie force à structurer ses journées, à automatiser ce qui peut l’être, à regrouper intelligemment les efforts. Pas pour devenir une machine, mais pour libérer du temps, le vôtre.




