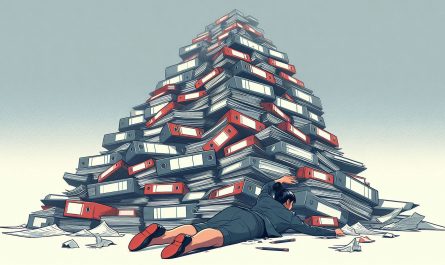Pendant longtemps, j’ai cru que la productivité, la vraie, se mesurait au bruit des touches de clavier à la minute et à la quantité de tâches rayées sur ma to-do list.
Évidemment, dans un monde où tout le monde court après le temps, ralentir peut sembler contre-intuitif.
Arrivé en fin de semaine, il m’arrivait de relire trois fois la même phrase sans rien comprendre. J’étais vidé, mais pas fatigué comme après une mauvaise nuit, non. Épuisé comme après trop de semaines à courir, avec toujours de la caféine dans le sang pour garder les yeux ouverts.
J’ai fini, après quelques années, par lever le pied, au début à contre-cœur pour des obligations familiales, puis au fil du temps par choix. Ainsi, j’ai découvert le nom anglo-saxon de ce concept à contre-courant de tout ce qu’on nous vend dans les livres de développement personnel : le slow working.
J’avoue, ça sonne comme un slogan de retraite spirituelle pour freelance surmené, mais plus je creusais, plus je me reconnaissais dans l’approche. Travailler plus lentement pour faire mieux, ne plus confondre vitesse et efficacité, choisir ses batailles et surtout avancer à un rythme plus humain, pas juste spectaculaire.
Voilà pourquoi il me semblait essentiel de partager ce que le slow working a changé pour moi et comment il peut vous aider, vous aussi, à reprendre la main sur votre temps et votre énergie, sans mettre vos ambitions de côté.
I. Le piège de la productivité à tout prix
La productivité, en soi, n’a rien de mauvais mais il est important de comprendre dans un premier temps la manière dont on l’a sacralisée et ce que cela implique.
1. Quand la suractivité devient une compétition toxique

Difficile aujourd’hui d’ouvrir LinkedIn sans tomber sur une publication du type : “Réveil à 5h, 10 calls dans la matinée, 3 cafés, 12 tâches bouclées avant midi. Let’s gooo ». Derrière ce genre de post bien lissé, on sent presque l’odeur du clavier surchauffé. C’est la norme aujourd’hui : faire beaucoup, vite, tout le temps et surtout, le montrer.
La culture du « toujours plus » glorifie la surcharge, l’agitation permanente, les agendas blindés à la minute près. Être débordé est presque devenu un insigne d’honneur. Un moyen d’affirmer qu’on a de la valeur, qu’on est important.
Le pire, c’est qu’on y croit…
Le slow working, à l’opposé de cette logique, invite à faire un pas de côté pour se demander si votre productivité actuelle est justifiée par une avancée réelle ou seulement pour ne pas décrocher d’un rythme imposé.
2. Le mythe de la productivité maximale comme seule voie du succès
On entend souvent que pour réussir, il faut optimiser chaque minute, rentabiliser son temps et ne jamais s’arrêter. Que chaque instant improductif est une opportunité manquée. Bref, si vous ne faites pas constamment quelque chose d’utile, vous êtes déjà en train de prendre du retard.
Elle repose sur une équation aussi simple que fausse : plus tu souffres = plus tu vaux.
C’est le cœur de la hustle culture. Cette idéologie qui glorifie l’épuisement comme preuve d’ambition, une vision du succès construite sur l’idée qu’il faut souffrir pour mériter et s’épuiser pour briller. Comme si le simple fait de vouloir respirer un peu entre deux projets était déjà un échec.
Le problème, c’est qu’à force d’y croire, vous devenez prisonnier de votre propre agenda. Impossible de prendre un moment pour vous, ni même des vacances sans culpabiliser, alors vous remplissez votre planner au maximum avec la certitude que c’est le seul moyen pour vous d’atteindre vos objectifs.
II. Les bénéfices du slow working
Maintenant que nous avons mis le doigt sur les conséquences de la surproductivité, voyons à présent les avantages à ralentir la cadence.
1. Meilleure qualité du travail et concentration accrue

Ce n’est pas nouveau, le multitâche donne l’illusion d’être efficace, mais en réalité, il morcelle l’attention et fatigue le cerveau bien plus vite qu’on ne le croit. Là-dessus, je ne vous apprends rien…
En ralentissant volontairement le rythme, on se donne la possibilité de se concentrer sur une seule chose à la fois. Travailler sans être interrompu toutes les deux minutes permet d’aller plus loin dans ses idées et de prendre le temps de peaufiner.
Mais attention, ralentir ne veut pas dire traîner. C’est rester concentré sur ce qui compte, sans s’éparpiller ni basculer dans la procrastination.
2. Une productivité plus régulière
Le problème quand vous accélérez à fond en début de semaine, c’est que vous finissez souvent les batteries à plat dès le jeudi. Trop de tension, pas assez de récupération et le cycle recommence. Une alternance de coups de boost et de gros coups de mou.
Le slow working, à l’inverse, repose sur une autre logique : celle du rythme soutenable. Un tempo plus constant, sans excès, sans dérapages. Pas besoin de courir tous les jours un sprint mais plutôt de vous habituer à un marathon. Ainsi, vous êtes plus régulier et moins à la merci des variations d’énergie.
Évidemment, il faut faire gaffe à ne pas basculer dans l’excès inverse. Travailler en mode “cool” tous les jours, sans structure, sans contraintes claires, ça ne tient pas non plus. Trop de souplesse tue le cadre de travail, ce qui vous fait tourner en rond.
3. Moins de stress et plus de plaisir au travail

Vous et moi, allons passer peut-être entre 70 à 80 % de notre vie à travailler. Alors, autant que ce soit supportable, voire mieux, agréable. Si vous êtes freelance, vous savez bien que c’est facile de devenir son propre tyran. Le genre de patron qui ne lâche rien, qui pousse à fond.
Le slow working remet tout ça en place. Il rappelle que le travail, ce n’est pas une souffrance à subir, mais un espace où on peut trouver du sens, du plaisir, et de la fierté. C’est personnellement cette approche qui m’a convaincu de franchir le pas.
Pour l’anecdote, certains sociologues auraient constaté un lien entre la crise de la quarantaine et l’essor du slow working. C’est souvent à ce moment-là que beaucoup commencent à remettre en question leur rapport au travail, leur rythme, leur épanouissement.
Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si de plus en plus de cadres quittent leur bureau (notamment depuis le covid-19) pour se reconvertir dans l’artisanat ou les métiers manuels jugés moins stressants, plus concrets, et surtout avec plus de sens au quotidien.
III. Ce que j’ai changé dans ma manière de travailler / Comment ralentir sans tout bouleverser
C’est beau sur le papier, mais dans la vraie vie, ça se passe comment ? Voici ce que j’ai ajusté pour intégrer le slow working sans faire exploser mon organisation.
1. Utiliser la matrice d’Eisenhower pour filtrer les tâches importantes
Il existe bien entendu d’autres méthodes mais c’est la plus simple que je connaisse. Plutôt que d’attaquer vos tâches comme si elles avaient toutes le même poids, la matrice d’Eisenhower vous invite à prendre une pause et à les répartir selon deux filtres : l’urgence et l’importance. L’idée, c’est de sortir du réflexe du “tout est prioritaire” en posant clairement ce qui mérite votre énergie maintenant et ce qui peut attendre (ou être évité).
Vous pouvez diviser les tâches en quatre grandes catégories, selon leur degré d’urgence et d’importance :
- Urgent et important : à traiter tout de suite.
- Important mais pas urgent : à planifier.
- Urgent mais pas important : à déléguer si possible.
- Ni urgent ni important : à supprimer ou repousser… loin.
Ça peut paraître simple, mais hiérarchiser de cette façon permet de retrouver une clarté immédiate. Vous arrêtez de répondre à tout dans l’instant. Vous réduisez les décisions inutiles et surtout, vous avancez sur ce qui a vraiment du poids.
2. Prenez des pauses à distance de votre espace de travail

Pour que le cerveau décroche vraiment, il faut sortir physiquement de votre environnement de travail. Bouger, changer de pièce, aller sur le balcon, marcher cinq minutes autour du pâté de maisons ou même vous étirer dans le couloir, peu importe, tant que vous vous éloignez de votre bureau et de vos écrans.
Pas besoin de partir une heure. Une vraie pause de cinq à dix minutes peut suffire à relancer la machine plus efficacement qu’un quart d’heure à traîner sur les réseaux.
3. Limitez le nombre d’outils de productivité
Notion, Trello, Google Calendar, l’appli de to-do, un tableur par projet, quelques post-its collés sur l’écran… et vous voilà en train de gérer un système plus complexe que le travail lui-même.
Le problème, c’est qu’à un moment, organiser devient une activité à part entière. Vous passez plus de temps à structurer votre planning qu’à avancer dessus. Vous avez l’impression d’être productif, mais en réalité, c’est juste une belle manière de procrastiner.
Ainsi, limiter le nombre d’outils, c’est faire de la place. Moins de fenêtres ouvertes, moins de frictions, plus de clarté sur ce qu’il y a à faire. Votre énergie est orientée vers l’action, pas vers la gestion de votre propre organisation. Un seul outil bien choisi et bien utilisé vaut largement mieux que cinq systèmes à moitié remplis.
4. Autorisez vous à finir plus tôt sans culpabiliser
On a été tellement habitués à mesurer notre valeur au temps passé à travailler que finir tôt donne presque l’impression de tricher. Comme si le seul travail valable était celui qui remplit toute la journée, même quand ce n’est plus nécessaire.
Ce réflexe est tenace, il pousse à rallonger artificiellement les tâches, juste pour ne pas avoir l’air de lever le pied. C’est absurde, mais fréquent et franchement contre-productif.
Alors, s’autoriser à fermer l’ordinateur plus tôt, ce n’est pas abandonner, c’est savoir s’arrêter quand le job est fait. C’est préserver son énergie au lieu de la griller pour remplir un quota imaginaire. C’est aussi créer de l’espace pour autre chose que le boulot, tel du repos, de la créativité, des bons moments.
Le slow working, c’est aussi ça, apprendre à ne pas remplir pour remplir. Reconnaître que la qualité ne dépend pas du temps passé, mais de l’énergie qu’on y met.
IV. Ce qu’il faut retenir
Au final, le slow working n’est pas un concept à la mode, mais une décision d’aborder vos journées sous un autre angle. Puisque, au fond, la manière dont vous travaillez en dit long sur vous. Elle reflète vos peurs, vos croyances et votre rapport à vous-même. Travailler en courant après le temps, c’est souvent une manière déguisée de chercher votre valeur dans la performance.
Évidemment, changer vous demandera du courage, pas parce que c’est compliqué, mais parce que c’est à contre-courant de tout ce que vous connaissez du monde. Certains trouveront votre comportement étrange et d’autres y verront un manque d’ambition de votre part. Alors je compte sur vous pour les laisser penser ce qu’ils veulent. Votre énergie ne leur appartient pas.
Vous avez juste à avancer à votre rythme et c’est largement suffisant.